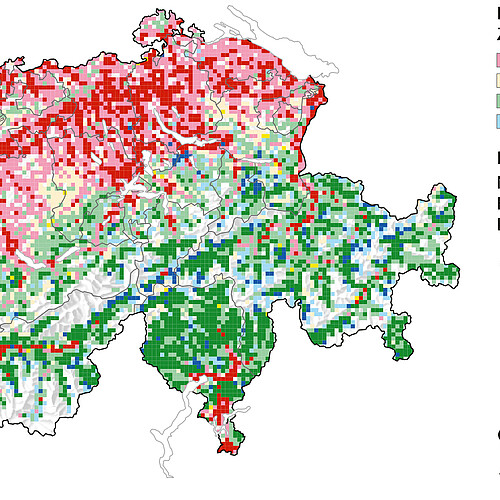- Perspectives
Peter Wohlleben, un druide contemporain?
01.07.2025

Essai
Abstract
Dans ses livres, Peter Wohlleben prétend que les arbres sont intelligents et sensibles, qu’ils sont capables de ressentir et de souffrir. Cette opinion contredit certes les faits établis scientifiquement, mais trouve aussi un terrain fertile chez de nombreux lecteurs. Que faut-il en conclure pour l’avenir de la gestion forestière? Et comment le secteur forestier peut-il réagir à cet engouement pour la sensibilité des arbres? L’essai se termine par des suggestions pour faire progresser la communication forestière en interne et avec la société.
Schweiz Z Forstwesen 176 (4): 215–219.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0215
* Rebbergstrasse 45, CH-8049 Zurich, courriel domont@sylvacom.ch
Jusqu’à quand les forestiers pourront-ils encore exploiter le bois des forêts si une minorité active au sein de la population fait émerger l’opinion selon laquelle les arbres sont intelligents et sensibles, qu’ils ressentent et qu’ils souffrent? Cette question est motivée entre autres par le succès commercial phénoménal des livres de Peter Wohlleben, notamment de son ouvrage le plus connu «La vie secrète des arbres» (Wohlleben, 2017)1. Les ouvrages de l’auteur allemand, traduits dans plus de 40 langues, occupent depuis des années une part très visible des rayons «Nature – Forêt – Arbres» des librairies. La confiance que les lecteurs témoignent à des auteurs comme Wohlleben confirme que la forêt et les arbres sont devenus une énorme surface de projection accueillant des rêves et des préoccupations sociétales de notre monde occidental. L’expression «religion de substitution» est souvent évoquée pour signifier que la nature est souvent perçue comme une entité omnisciente, l’être humain étant relégué au statut d’être gauche et inapte. Cette tendance semble compatible avec le rejet persistant des formes d’autorité existantes. Wohlleben serait ainsi un représentant d’une nouvelle génération de druides, interprètes d’une nature à nouveau déifiée, ou du moins portée au niveau de l’humain.
Des faits à l’interprétation idéologique
L’auteur est sans aucun doute un narrateur brillant, qui aime transmettre son propre point de vue non seulement sur la forêt et les arbres, mais aussi sur l’environnement et sur une multitude d’autres domaines spécialisés. Il ne critique pas seulement «la sylviculture», mais aussi l’évolution de la société, notamment la surpopulation de la planète (Wohlleben, 2010). Wohlleben formule de nombreuses observations intéressantes et correctes sur la forêt et les arbres. Malheureusement, les interprétations, les évocations suggestives, les insinuations, l’attribution systématique de caractéristiques humaines supérieures aux arbres (anthropomorphisme) ainsi que de nombreux autres instruments rhétoriques tels que l’exagération, l’éclairage unilatéral ou la généralisation posent problème. Il ne s’agit finalement plus d’un «transfert de connaissances», mais plutôt d’une instrumentalisation du savoir. Les scientifiques soulignent en outre nombre d’informations erronées.
Les deux exemples suivants illustrent la transition entre faits établis et fausses informations.
Dans une interview accordée à la chaîne allemande SWR2 (2021), la présentatrice donne le champ libre à son invité pour commenter les récentes inondations catastrophiques en Allemagne. Wohlleben critique d’une voix calme et amicale les machines forestières modernes utilisées en forêt: ces lourds engins de récolte détruiraient le sol forestier en le comprimant (généralisation) et creuseraient en outre des sillons où s’écoulerait l’eau de pluie sans entraves, provoquant les inondations en plaine (conclusion erronée). En revanche, les hêtraies qu’il gère avec soin ou dont il abandonne l’exploitation «laisseraient tout s’infiltrer»2 (exagération). D’une observation locale (sol endommagé par un engin mal utilisé), Wohlleben passe à des destructions générales à l’échelle du pays. De plus, il ne mentionne pas le savoir forestier bien établi, comme quoi la forêt ne peut exercer qu’une influence très limitée sur l’écoulement global et les inondations après de très fortes précipitations.
L’un des narratifs les plus connus de Wohlleben est celui de l’attention maternelle que les hêtres-mères apporteraient à leurs rejetons. Se référant aux publications de la chercheuse canadienne Suzanne Simard3 sur les douglas, il répète dans des livres et de nombreuses interviews que les hêtres-mères nourrissent («allaitent») leurs rejetons avec sollicitude et qu’ils accordent une préférence à leurs propres «enfants». Simard affirme même que les douglas-mères modifient la structure de leurs racines pour faire de la place aux bébés arbres dans le sol.
Pourtant, une connaissance élémentaire de l’écosystème forestier permet déjà de savoir qu’un hêtre ne peut pas être une «mère nourricière» attentionnée. Au contraire, c’est l’inversion de la métaphore qui devrait s’imposer: des hêtres «infanticides multirécidivistes» qui, chaque année, étouffent des milliers de leurs rejetons, leurs «bébés», dans un processus atrocement lent sous leur ombre épaisse.
Toutefois, la grande majorité de la population n’a pas accès aux connaissances scientifiques de base. Elle fait confiance aux auteurs célébrés par les médias, dans la mesure où leurs messages sont conformes à ses propres valeurs ou surfent sur l’air du temps. «Arbre-mère» est aussi une métaphore utilisée par les forestiers, mais chez Wohlleben, l’expression est efficacement anthropomorphisée.
Travail astreignant pour apporter des preuves
Plusieurs scientifiques ont pris la peine d’évaluer et de contredire certaines affirmations de Wohlleben. David Robinson, soutenu par 35 autres chercheurs, a démontré dans une analyse détaillée que «l’alimentation» (transfert de C) des plantules par l’arbre-mère a lieu en quantités si infimes que l’on ne peut pas parler de transfert et en outre que ces traces de C ne passent pas non plus de manière privilégiée à la propre progéniture4.
La démonstration scientifique que telle ou telle affirmation est fausse nécessite beaucoup de travail et requiert généralement des connaissances spécialisées dans plusieurs domaines de recherche. Le langage des chercheurs et des spécialistes est généralement prudent et ne cache pas les incertitudes – contrairement aux affirmations simplistes que le public peut accueillir confortablement.
Il est en outre fastidieux, c’est dans la nature des choses, d’apporter la preuve que quelque chose n’existe pas. Le mythe touristique du monstre du Loch Ness en Ecosse en est un bel exemple depuis des décennies5. Narratifs et légendes s’avèrent ainsi étonnamment résilients face à des faits établis lorsqu’ils plaisent spontanément. Les historiens connaissent également l’importance des légendes pour expliquer ou transfigurer le passé. Ainsi Volker Reinhardt, qui déclare: «Les êtres humains en ont besoin parce que les légendes nous rassurent, nous offrent des repères dans le flux du temps. Ce genre d’histoires est une sorte de thérapie pour le présent.6»
Même les personnes de formation universitaire (mais pas nécessairement en sciences naturelles) peuvent réagir positivement aux affirmations et aux interprétations de Wohlleben. Elles accordent une certaine pertinence au livre, le considèrent comme une révélation et pensent avoir découvert des faits jusqu’alors inconnus. Il en résulte ce que l’on appelle une théorie du complot, selon laquelle les «autorités» actuelles (politiques, scientifiques, économiques …) cacheraient la vérité et que, heureusement, des auteurs courageux révéleraient la vraie réalité.
Comment expliquer un tel succès
Comment s’explique le succès d’une livre comme «La vie secrète des arbres»? Pour Christian Schröder, le succès d’un tel livre provient d’un nouvel «esprit du temps», dans une société qui allie la surconsommation et un sentiment d’inadéquation, de mauvais fonctionnement. «Et puis un forestier vient nous parler d’un système qui fonctionne à merveille, dans lequel tout le monde s’entraide, le tout emballé dans un charmant langage. Cela éveille en nous une sorte de nostalgie devant ce grandiose fonctionnement de la nature.2»
Ainsi, les «arbres attentionnés» pourraient éventuellement refléter un besoin plus profond dans notre société de plus en plus individualiste et anonyme. Il semble aussi qu’aujourd’hui, la nature soit de plus en plus associée au «bien» et l’homme au «mal». Il n’y a donc pas grand intérêt à séparer les faits des vœux pieux, si ces derniers sont au bénéfice d’une nature bonne par définition7.
Un peu plus simplement et fondamentalement, Gérald Bronner8 rappelle que l’homme préfère se servir d’arguments confortables plutôt que de chercher, parfois péniblement, des informations avérées. La «paresse intellectuelle», les incessants «calculs coûts-bénéfices» de nos cerveaux humains rendent souvent le possible plus attrayant que le vrai. Un effort est donc nécessaire pour résister aux récits qui séduisent.
Wohlleben puise aussi des informations chez des personnes ayant un statut de chercheurs, notamment auprès de ceux qui tentent depuis quelques années d’établir une discipline qu’ils appellent neurobiologie végétale. Nous ne sommes pas loin du débat en cours sur la question de savoir si l’IA confère une âme aux robots. La grande majorité des spécialistes en biologie végétale critiquent le terme même de «neurobiologie» pour les végétaux, qui repose sur l’hypothèse d’une similitude avec les animaux. Ils sont également très prudents avec le terme «intelligence» chez les plantes et exigent davantage de clarté et de raison9.
L’intérêt des médias pour les arbres s’est développé parallèlement à la sensibilité croissante de la société pour nos grands compagnons ligneux, sensibilité qui se développe depuis des décennies (entre autres en lien avec la problématique des forêts tropicales). Les médias vivent de ce qui intéresse leurs clientes et leurs clients. Depuis toujours, les médias cherchent à toucher les émotions, sont friands de conflits et de tout ce qui semble nouveau, rare ou dramatique. Ils portent certes une responsabilité juridique pour la véracité de leurs informations, mais pas nécessairement pour la vérité10.
Depuis la parution de son best-seller en 2015, Wohlleben a reçu les faveurs des médias, qui l’ont courtisé. L’auteur se dit lui-même surpris de son succès. Peu de médias se sont montrés critiques à l’égard de Wohlleben, comme la NZZ en 2018: «Il est frappant de constater que dès que l’on parle de mémoire végétale, d’alertes et d’appels à l’aide entre plantes ou encore de réaction à la douleur, un certain nombre de guillemets sont indispensables. Car en matière de végétaux, la tendance à séduire par des analogies anthropomorphiques trompeuses est endémique.11»
Comment réagir à Wohlleben?
On peut saluer de bonne grâce le succès obtenu par l’auteur, les maisons d’édition et les librairies. Mais que signifie ce succès pour la définition à long terme d’une «bonne gestion forestière»? Le modèle de développement durable est-il encore défendu? Après la conférence de l’ONU sur le climat à Rio (1992), il s’agissait de considérer l’économie comme étant sur un pied d’égalité avec le social et l’environnement. Mais la protection de l’environnement (par exemple le stockage de CO2 dans le bois) semble aujourd’hui moins intéresser les médias et le public que la protection de la nature et la biodiversité omniprésente.
On peut douter que le secteur forestier puisse à lui seul contrecarrer cette tendance, car nous avons affaire à une large évolution de la société. Mais où va-t-on si les citoyens sont de plus en plus convaincus que la «bonne nature»12 a de plus en plus besoin d’être protégée contre les «méchants humains»? Cette question complexe mériterait d’être largement débattue dans le cadre d’un concept de durabilité véritablement global. Le monde forestier peut y participer avec beaucoup de compétences. La question des Lumières se pose avec encore plus d’acuité: la critique de la raison (scientifique) et de l’«anthropocentrisme» et la relativisation du savoir qui en découle («la science n’est pas tout») vont-elles ouvrir le chemin à des législations basées sur des points de vue ésotériques?
Et comment réagit le secteur forestier?
Comme indiqué plus haut, des scientifiques allemands ont soigneusement analysé le récit de la «vie secrète» des arbres (Christian Ammer, David G. Robinson, Torben Halbe et d’autres)13. Sinon, les milieux forestiers n’ont guère discuté des livres de Wohlleben jusqu’à présent. On trouve certes quelques commentaires intéressants et critiques de la part de spécialistes sur Internet. L’ambiance est plutôt détendue: l’auteur exagérerait, les réflexions anthropomorphiques seraient simplement ridicules, voire poétiques.
En Suisse non plus, la presse forestière n’a pas réagi jusqu’ici aux best-sellers de Wohlleben. Face à des contenus si erronés et fantaisistes, une intervention n’a pas semblé indispensable. Pourtant, même couplés à des opinions ésotériques et critiques vis-à-vis de la science et de la foresterie, les succès de l’auteur allemand auprès d’un large public devraient être pris au sérieux. Ils posent la question de l’importance du dialogue entre les spécialistes et leurs divers publics. En termes politiques: même une personne mal informée dispose d’une carte de vote valable.
Les brèves réflexions suivantes sur les relations publiques du secteur forestier se veulent être des suggestions et une invitation à la discussion.
Tâche 1: renforcer les compétences de communication en interne
Les institutions forestières (recherche, administration, formation, propriété forestière) disposent des ressources nécessaires pour améliorer en interne les compétences des acteurs forestiers dans le domaine de la communication. Il ne s’agit pas seulement de produire des messages sur les thèmes forestiers traditionnels (sylviculture, climat, forêt de protection, exploitation du bois, biodiversité …). Il est aussi essentiel de pouvoir aborder les sujets «soft» que sont la communication, la sociologie ou la psychologie en lien avec la perception de la forêt par le public. Car peut-on convaincre ses propres publics sans décrire sobrement la démarche d’un auteur comme Wohlleben et faire la différence entre approche objective et manipulatrice? Les institutions qui forment des praticiens forestiers devraient accorder au domaine de la communication pratique une priorité beaucoup plus élevée que jusqu’à présent et réduire en contrepartie les détails techniques des programmes de formation.
Tâche 2: travailler à la communication stratégique vers l’extérieur
Parmi les nombreux groupes cibles du monde forestier, mentionnons brièvement les médias (presse quotidienne, revues spécialisées, revues grand public, médias sociaux). Les institutions forestières n’ont pas les ressources nécessaires pour établir seules un «contre-narratif» aux visions ésotériques du moment, qui s’expriment non seulement sur des questions d’environnement, mais par exemple aussi sur la santé, l’alimentation ou la protection des animaux. Dans le cas qui nous occupe, l’approche d’Ammer évoquée plus haut semble être pragmatique et efficace: prendre contact directement et de manière constructive avec les médias lorsque la qualité de leurs informations laisse à désirer. Il s’agit d’effectuer un travail de relations publiques plus actif au niveau local et national, notamment en abordant la relation émotionnelle avec les arbres et la forêt – les forestiers doivent aussi montrer qu’ils ont des sentiments et ne pas hésiter à raconter ce qui les touche personnellement. De sérieux défis se posent aussi aux médias: l’exemple de Wohlleben montre clairement que les journalistes scientifiques font aujourd’hui cruellement défaut – une lacune qui s’accentuera encore avec la montée de l’IA.
Soumis: 16 novembre 2024, accepté (sans comité de lecture): 14 avril 2025
Fussnoten
Le titre de même que le contenu s’appuient sur le best-seller «La vie secrète des plantes» de Peter Tomkins et Christopher Bird paru en 1975 déjà. Les éditions ultérieures ont reçu le sous-titre «Un récit fascinant sur les relations physiques, émotionnelles et spirituelles entre les plantes et l’homme».
Interview de Peter Wohlleben par Brigitte Schulz à la télévision allemande SWR2 «Der Wald des Peter Wohlleben – Nur Wunsch oder Wirklichkeit?» le 25 août 2021.https://www.swr.de/swrkultur/wissen/der-wald-des-peter-wohlleben-nur-wunsch-oder-wirklichkeit-100.html; l’émission a également produit une documentation présentant des opinions contradictoires sur le sujet avec Christian Ammer, Pierre Ibisch, Christian Schröder et Torben Halbe.
Concernant l’ouvrage de Suzanne Simard «Finding the Mother Tree» (FR: A la recherche de l’arbre-mère – Découvrir la sagesse de la forêt), voir la critique de Robinson (2024, op. cit.) et Wikipediahttps://de.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Simard
Robinson D et al (2024) extrait: «(…) the author of this book, ascribes to plants (in this case trees) a number of human characteristics: feeling pain, being happy and caring for other trees, being able to communicate with other trees, and being capable of creating strategies for the benefit of the group. These are hallmarks of conscious organisms, for which there is zero credible evidence.» Robinson & Fitter (1999) ont déjà publié des résultats de recherches sur la question du transfert de C par les racines et le mycélium des champignons.
Chaque année, plus d’un million de touristes rejoignent le biotope présumé du monstre du Loch Ness en Écosse, un lac de la taille du lac de Zurich. Des milliers de visiteurs recherchent des signes de vie de l’animal mythique. Il s’agit d’une situation de rêve pour le marketing d’une région dont le monstre génère plus de 100 millions de francs par an. Voir par exemple l’article d’Eva Oberholzer (2023): Die grösste Suche nach dem Ungeheuer von Loch Ness seit 50 Jahren bringt neue Erkenntnisse: vier «gloops». In: NZZ du 28 août 2023.
Jutzet N (2016): «Die Menschen brauchen Legenden», Interview du prof. Volker Reinhardt. In: Freiburger Nachrichten du 21 septembre 2016.http://www.freiburger-nachrichten.ch/grossfreiburg/die-menschen-brauchen-legenden
Voir l’article de Michael Schmidt-Salomon «Die Natur ist nicht gut» (La nature n’est pas bonne), in: NZZ du 30 août 2024:https://www.nzz.ch/folio/die-natur-ist-nicht-gut-und-der-mensch-nicht-boese-ld.1844851
Professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot qui s’intéresse à la manière dont les légendes se construisent au quotidien. Source: Brunner, G. (2021): L’empire des croyances. Paris, puf.
Concernant les controverses sur l’intelligence des plantes, voir Quentin Hiernaux, «Du comportement végétal à l’intelligence des plantes?», éditions Quae, 2020.
Selon Mischa Senn, maître de conférences en droit des médias et de la publicité ainsi qu’expert et vice-président de la Commission suisse pour la loyauté, la responsabilité des médias se limite à la véracité (et seulement de manière limitée à la vérité ou à l’exactitude). La véracité se réfère à la perception subjective, c’est-à-dire à ce qui est considéré personnellement comme vrai en toute conscience (in: Mischa Senn, Vorschlag für mehr Medienkompetenz: zuerst einfach mal alles für unwahr halten, was man in den sozialen Netzwerken liest, NZZ du 7 octobre 2024). Pour les maisons d’édition, cette responsabilité n’est pas réglée juridiquement (M. Senn, commun. pers.).
Kaeser, E. (2018): Das gar nicht mehr so geheime intelligente Leben der Pflanzen. In: NZZ du 14 mars 2018
Schmidt-Salomon M (2024): Das Konzept der Klimaneutralität ist zu kurz gedacht: Die Natur ist nicht gut – und der Mensch nicht böse in NZZ vomhttps://www.nzz.ch/folio/die-natur-ist-nicht-gut-und-der-mensch-nicht-boese-ld.1844851
Professeur de sylviculture et d’écologie forestière à l’Université de Göttingen, Christian Ammer a adressé en 2017 aux médias une pétition signée par plus de 4500 scientifiques et institutions. Il demande ainsi aux journalistes de solliciter et prendre en compte l’avis critique des scientifiques. Lors d’une édition ultérieure du livre de Wohlleben en 2017, les prises de contact des médias avec les scientifiques ont effectivement nettement augmenté. Le biologiste Torben Halbe a écrit un «contre-livre»: «La vraie vie des arbres» et explique d’un point de vue scientifique pourquoi les arbres ne peuvent pas penser ou ressentir.
Literatur
Das wahre Leben der Bäume: Ein Buch gegen eingebildeten Umweltschutz. Schmallenberg: WOLL-Verlag. 192 p.
Mother trees, altruistic fungi, and the perils of plant personification. Trends Plant Sci (29): 20–31. doi:https://doi.org/10.1016/j.tplants.2023.08.010
The magnitude and control of carbon transfer between plants linked by a common mycorrhizal network. J Exp Bot (50): 9–13. doi:https://doi.org/10.1093/jxb/50.330.9
The Secret Life of Plants. New York: Harper & Row. ISBN 0-06-091587-0. 402 p.
Evolution 2.0 – Macht und Ohnmacht des Homo sapiens. Berlin: wjs.
Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren. Die Entdeckung einer verborgenen Welt. München: Ludwig. 224 p.